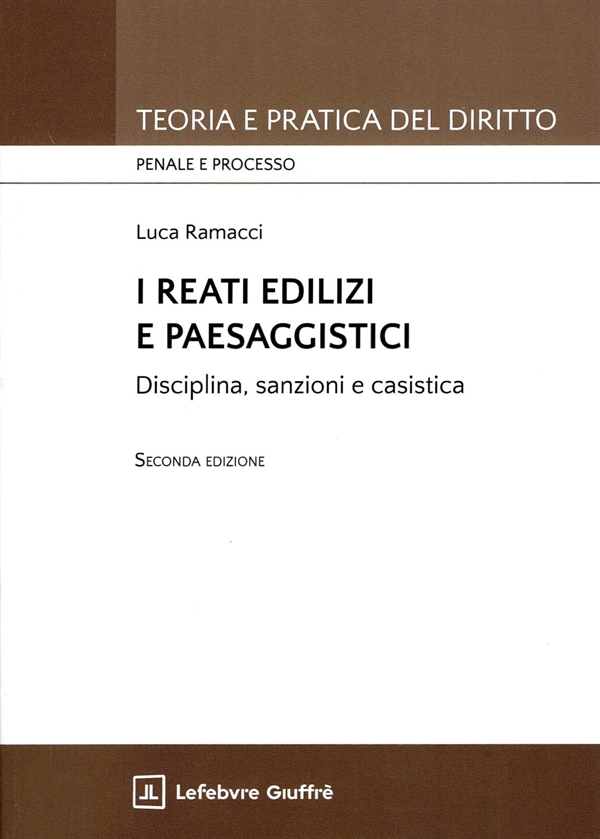SUD FONDI s.r.l. e altri contro Italia
(ricorso n° 75909/01)
ARTICOLO 7 – NULLA POENA SINE LEGE
ARICOLO 1 PROTOCOLLO N° 1 – PRIVAZIONE DELLA PROPRIETA’
Questa decisione riguarda il caso di PUNTA PEROTTI, la lottizzazione avvenuta negli anni ’90 sul lungomare di Bari. La mancanza di chiarezza e di trasparenza delle norme urbanistiche regionali ha permesso il rilascio di concessioni edilizie, in palese violazione dei vincoli paesaggistici imposti dalla normativa nazionale. In conseguenza, l’autorità penale ha assolto i costruttori perché il fatto non costituisce reato. Nonostante ciò, l’autorità penale ha ritenuto doveroso confiscare gli edifici costruiti e i terreni facenti parte della lottizzazione, essendo quest’ultima illegale.
E’ ora all’attenzione della CEDU l’adozione di tale misura.
Segnalazione e commento a cura dell’avv. Antonella Mascia
Il ricorso è stato presentato da alcune società, proprietarie di alcuni terreni situati in riva al mare, nei pressi di Bari. Tali società, su autorizzazione dell’amministrazione comunale, procedettero alla costruzione di un complesso immobiliare, comunemente conosciuto come “Punta Perotti”.
L’autorità penale competente, ritenendo che le costruzioni fossero state eseguite su un sito naturale protetto, ordinò il loro sequestro preventivo. Le ricorrenti fecero ricorso in Cassazione. La Suprema Corte annullò la misura conservativa ordinando la restituzione dei beni, dato che, secondo il piano urbanistico, il sito non era stato assoggettato ad alcun divieto di edificazione.
Nel frattempo, per la stessa lottizzazione, le società e i loro legali rappresentanti furono iscritti nel registro degli indagati. L’azione penale si concluse in Cassazione. La Suprema Corte, pur ritenendo che la lottizzazione fosse illegale, in quanto avvenuta in violazione del divieto assoluto di edificare in un sito assoggettato a vincolo paesaggistico, assolse gli imputati perché il fatto non costituiva reato. Questi ultimi infatti erano stati indotti all’errore, ritenuto dalla Corte di Cassazione inevitabile e scusabile, in quanto le disposizioni regionali dovevano considerarsi “oscure e mal formulate” e in contrasto con la normativa nazionale. Inoltre anche la condotta tenuta dalle autorità amministrative coinvolte nel rilascio delle concessioni edilizie avevano indotto in errore gli imputati.
Nonostante l’assoluzione degli imputati, la Corte di Cassazione ordinò la confisca di tutte le costruzioni e dei terreni facenti parte della lottizzazione. Secondo la Corte di Cassazione, tale misura doveva essere adottata anche in assenza di responsabilità penale in quanto si era comunque in presenza di una lottizzazione illegale.
A seguito di tale sentenza, la proprietà dei terreni venne trasferita al Comune di Bari. Gli immobili costruiti o ancora in fase di costruzione si estendevano su una superficie di 7.000 metri quadrati, mentre gli altri terreni confiscati avevano un’estensione di 50.000 metri quadrati. Recentemente, tre immobili sono stati demoliti.
La CEDU ha ritenuto applicabile al caso di specie l’articolo 7 della Convenzione (nulla poena sine lege).
Le società ricorrenti o i loro rappresentanti sono stati assolti, non sussistendo l’elemento psicologico del reato contestato.
Tuttavia, secondo la CEDU, la confisca degli edifici e dei terreni deve considerarsi come una “pena”.
Questo perché:
- tale misura si ricollega ad un illecito penale fondato su principi giuridici generali;
- il carattere illegale delle lottizzazioni è stato constatato dal giudice penale;
- la confisca è stata ordinata per ragioni obiettive, senza che sia stato possibile stabilire l’esistenza di una intenzione o negligenza da parte delle ricorrenti;
- la sanzione aveva lo scopo di punire al fine di impedire la reiterazione della violazione alla legge e non di risarcire un pregiudizio;
- la gravità della sanzione che, secondo la legge applicabile al caso di specie, ha compreso tutti i terreni inclusi nel progetto di lottizzazione colpendo, in pratica, 50.000 metri quadrati di terreno;
- il codice di costruzione del 2001 identifica tale confisca come una sanzione penale.
La CEDU ha ritenuto applicabile l’articolo 7 della Convenzione, dichiarando il ricorso ricevibile. La CEDU ha inoltre dichiarato ricevibile il ricorso anche sotto il profilo di cui all’articolo 1 del Protocollo n° 1 (privazione della proprietà).
Segue la versione originale della decisione, in lingua francese.

de la requête no 75909/01
présentée par SUD FONDI srl et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 août 2007 en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 septembre 2001,
Vu la décision partielle du 23 septembre 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
Les requérantes, Sud Fondi srl, MABAR srl et IEMA srl, trois sociétés ayant leur siège à Bari, étaient propriétaires des constructions et terrains objets de la requête.
Elles sont représentées devant la Cour par Me A. Giardina, Me Francesca Pietrangeli et Me Pasquale Medina, avocats à Rome.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son, agent, M. I.M. Braguglia, et son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. L’adoption des conventions de lotissement
La société Sud Fondi srl (infra « la première requérante ») était propriétaire d’un terrain sis à Bari, sur la côte de Punta Perotti, classé comme constructible par le plan général d’urbanisme (piano regolatore generale), et destiné à être utilisé dans le secteur tertiaire par les dispositions techniques du plan général d’urbanisme.
Par l’arrêté no 1042 du 11 mai 1992, le Conseil municipal de Bari approuva le projet de lotissement (piano di lottizzazione) présenté par cette société relativement à une partie de son terrain, dont la surface globale était de 58 410 mètres carrés. Ce projet – qui avait été pré-adopté le 20 mars 1990 - prévoyait la construction d’un complexe multifonctionnel, à savoir d’habitations, bureaux et magasins.
Le 3 novembre 1993, la première requérante et la Mairie de Bari conclurent une convention de lotissement ayant pour objet la construction d’un complexe de 199 327 mètres cubes ; en contrepartie la requérante céderait à la municipalité 36 571 mètres carrés dudit terrain.
Le 19 octobre 1995, l’administration municipale de Bari délivra le permis de construire.
Le 14 février 1996, la première requérante entama les travaux de construction, qui furent en grande partie terminés avant le 17 mars 1997.
Par l’arrêté no 1034 du 11 mai 1992, le Conseil municipal de Bari approuva un projet de lotissement (qui avait été pré-adopté le 20 mars 1990) concernant la construction d’un complexe multifonctionnel à réaliser sur un terrain de 41 885 mètres carrés classé comme constructible par le plan général d’urbanisme et limitrophe à celui de propriété de la société Sud Fondi srl.
Les sociétés MABAR srl et IMCAR srl étaient propriétaires, respectivement, de 13 095 mètres carrés et 2 726 mètres carrés de ce terrain.
Le 1er décembre 1993, la société MABAR srl (infra « la deuxième requérante ») conclut avec l’administration municipale de Bari une convention de lotissement prévoyant la construction d’habitations et bureaux pour 45 610 mètres cubes ; elle céderait à la municipalité 6 539 mètres carrés de terrain.
Le 3 octobre 1995, la Mairie de Bari délivra le permis de construire.
La deuxième requérante entama les travaux de construction ; il ressort du dossier qu’au 17 mars 1997, seules les fondations des bâtiments avaient été réalisées.
Le 21 juin 1993, la société IMCAR srl conclut avec l’administration municipale de Bari une convention de lotissement prévoyant la construction d’un complexe de 9 150 mètres cubes, ainsi que la cession à la municipalité de 1 319 mètres carrés de terrain.
Le 28 mars 1994, la société IMCAR srl vendit son terrain à la société IEMA srl.
Le 14 juillet 1995, la Mairie de Bari délivra à la société IEMA srl (infra « la troisième requérante ») un permis de construire des habitations, des bureaux et un hôtel.
La troisième requérante entama les travaux de construction. Il ressort du dossier qu’au 17 mars 1997, une partie du complexe avait été terminée.
Entre-temps, le 10 février 1997, l’autorité nationale pour la protection du paysage (Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali) s’était plainte auprès du maire de Bari de ce que les zones côtières soumises à une contrainte de paysage, telles qu’elles ressortaient des documents annexés au plan urbain de mise en œuvre, ne coïncidaient pas avec les zones marquées en rouge sur la planimétrie qui avait été transmise en 1984.
Il ressort du dossier qu’au moment de l’approbation des projets de lotissement litigieux, aucun plan urbain de mise en œuvre (piano di attuazione) du plan général d’urbanisme de Bari n’était en vigueur. En effet, le plan de mise en œuvre du 9 septembre 1986, en vigueur au moment de la pré-adoption des projets, avait expiré le 9 septembre 1991. Antérieurement, la ville de Bari avait élaboré un autre plan urbain de mise en œuvre, en vigueur du 29 décembre 1980 au 29 décembre 1985.
A la suite de la publication d’un article de presse concernant les travaux de construction effectués à proximité de la mer à « Punta Perotti », le 27 avril 1996, le procureur de la République de Bari ouvrit une enquête pénale.
Le 17 mars 1997, le procureur de la République ordonna la saisie conservatoire de l’ensemble des constructions litigieuses. Par ailleurs, il inscrivit dans le registre des personnes faisant l’objet de poursuites pénales les noms de Michele Matarrese Senior, Domenico Andidero et Antonio Quiselli, en tant que représentants respectifs des sociétés Sud Fondi srl, MABAR srl et IEMA srl, ainsi que les noms de trois autres personnes, en tant que directeurs et responsables des travaux de construction. Le procureur de la République estimait que la localité dénommée « Punta Perotti » était un site naturel protégé et que, par conséquent, l’édification du complexe était illégale.
Les requérantes attaquèrent la mesure de saisie conservatoire devant la Cour de cassation.
Par une décision du 17 novembre 1997, la Cour de cassation annula cette mesure et ordonna la restitution de l’ensemble des constructions aux propriétaires, au motif que le site n’était frappé d’aucune interdiction de bâtir par le plan d’urbanisme.
Par un jugement du 10 février 1999, le tribunal de Bari reconnut le caractère illégal des immeubles à « Punta Perotti » puisque non conformes à la loi no 431 de 1985 (« loi Galasso »), qui interdisait de délivrer des permis de construire relatifs aux sites d’intérêt naturel, parmi lesquelles figurent les zones côtières. Toutefois, vu qu’en l’espèce l’administration locale avait bien délivré les permis de construire, et vu la difficulté de coordination entre la loi no 431 de 1985 et la législation régionale, qui présentait des lacunes, le tribunal estima qu’il ne pouvait être reproché aux accusés ni faute ni intention. Par conséquent, le tribunal acquitta tous les accusés à défaut d’élément moral (« perché il fatto non costituisce reato »).
Dans ce même jugement, estimant que les projets de lotissement étaient matériellement contraires à la loi no 47 de 1985 et de nature illégale, le tribunal de Bari ordonna, aux termes de l’article 19 de cette loi, la confiscation de l’ensemble des terrains lotis à « Punta Perotti », ainsi que des immeubles y construits, et leur acquisition au patrimoine de la Mairie de Bari.
Par un arrêté du 30 juin 1999, le Ministre du Patrimoine (« Ministro dei beni culturali ») décréta une interdiction de construire dans la zone côtière près de la ville de Bari, y compris « Punta Perotti », au motif qu’il s’agissait d’un site de haut intérêt naturel. Cette mesure fut annulée par le tribunal administratif régional l’année suivante.
Le Procureur de la République interjeta appel du jugement du tribunal de Bari, demandant la condamnation des accusés.
Par un arrêt du 5 juin 2000, la cour d’appel réforma la décision de première instance. Elle estima que la délivrance des permis de construire était légale, en l’absence d’interdictions de bâtir à « Punta Perotti » et vu l’absence d’apparente illégalité dans la procédure d’adoption et approbation des conventions de lotissement.
Par conséquent, la cour d’appel acquitta les accusés au motif que l’élément matériel de l’infraction faisait défaut (« perché il fatto non sussiste ») et révoqua la mesure de confiscation de l’ensemble des constructions et terrains.
Le 27 octobre 2000, le Procureur de la République se pourvut en cassation.
Par un arrêt du 29 janvier 2001, déposé au greffe le 26 mars 2001, la Cour de cassation cassa sans renvoi la décision de la cour d’appel. Elle reconnut l’illégalité matérielle des projets de lotissement, au motif que les terrains concernés était frappés d’une interdiction absolue de construire et d’une contrainte de paysage, imposées par la loi. A cet égard, la cour releva qu’au moment de l’adoption des projets de lotissement (le 20 mars 1990), la loi régionale no 30 de 1990 en matière de protection du paysage n’était pas encore en vigueur. Par conséquent, les dispositions applicables en l’espèce étaient celles de la loi régionale no 56 de 1980 (en matière d’urbanisme) et la loi nationale no 431 de 1985 (en matière de protection du paysage).
Or, la loi no 56 de 1980 imposait une interdiction de construire au sens de l’article 51 F), à laquelle les circonstances de l’espèce ne permettaient pas de déroger. En effet, les projets de lotissement concernaient des terrains non situés dans l’agglomération urbaine. En outre, au moment de l’adoption des conventions de lotissement, les terrains concernés étaient inclus dans un plan urbain de mise en œuvre du plan général d’urbanisme qui était postérieur à l’entrée en vigueur de la loi régionale no 56 de 1980.
Enfin, la Cour de cassation releva qu’en mars 1992, soit au moment de l’approbation des projets de lotissement, aucun programme urbain de mise en œuvre n’était en vigueur. A cet égard la Cour rappela sa jurisprudence selon laquelle il fallait qu’un plan urbain de mise en œuvre soit en vigueur au moment de l’approbation des projets de lotissement (Cour de cassation Section 3, 21.197, Volpe ; 9.6.97, Varvara ; 24.3.98, Lucifero). Ceci puisque – toujours selon la jurisprudence – une fois un plan urbain de mise en œuvre expiré, l’interdiction de construire à laquelle le programme avait mis fin redéployait ses effets. Par conséquent, il fallait retenir l’existence de l’interdiction de construire sur les terrains en cause, au moment de l’approbation des projets de lotissement.
La Cour de cassation retint également l’existence d’une contrainte de paysage au sens de l’article 1 de la loi nationale no 431 de 1985. En l’espèce, l’avis de conformité avec la protection du paysage de la part des autorités compétentes faisait défaut (à savoir il n’y avait ni le nulla osta délivré par les autorités nationales et attestant de la conformité avec la protection du paysage - au sens de l’article 28 de la loi no 1150/1942 - ni l’avis préalable des autorités régionales selon les articles 21 et 27 de la loi no 1150/1942 et de l’avis du comité régional pour l’urbanisme prévu aux articles 21 et 27 de la loi régionale no 56/1980).
Enfin, la Cour de cassation releva que les projets de lotissement ne concernaient que 41 885 mètres carrés, alors que selon les dispositions techniques du plan général d’urbanisme de la ville de Bari la surface minimale était fixée à 50 000 mètres carrés.
A la lumière de ces considérations, la Cour de cassation retint donc le caractère illégal de projets de lotissement et des permis de construire délivrés. Elle acquitta les accusés au motif qu’il ne pouvait leur être reproché ni faute ni intention de commettre les faits délictueux et qu’ils avaient commis une « erreur inévitable et excusable » dans l’interprétation de dispositions régionales « obscures et mal formulées » et qui interféraient avec la loi nationale. La Cour de cassation prit également en compte le comportement des autorités administratives, et notamment le fait que, à l’obtention des permis de construire, les requérants avaient été rassurés par le directeur du bureau communal compétent ; que les interdictions visant la protection des sites contre lesquelles le projet de construction se heurtait ne figuraient pas dans le plan d’urbanisme ; que l’administration nationale compétente n’était pas intervenue.
Par le même arrêt, la Cour de cassation ordonna la confiscation de l’ensemble des constructions et des terrains, au motif que, conformément à sa jurisprudence, l’application de l’article 19 de la loi no 47 de 1985 était obligatoire en cas de lotissement illégal, même en l’absence d’une condamnation pénale des constructeurs.
3. Les développements postérieurs à l’issue de la procédure
Le 23 avril 2001, l’administration municipale communiqua aux sociétés Sud Fondi srl, MABAR srl et IEMA srl qu’à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2001, la propriété des terrains dédites sociétés sis à « Punta Perotti » avait été transférée à la municipalité.
Le 27 juin 2001, l’administration municipale de Bari procéda à l’occupation matérielle des terrains ainsi que des immeubles y construits.
Il ressort du dossier que les immeubles bâtis entre-temps ou encore en phase de construction s’étendaient sur une surface de 7 000 mètres carrés, et que les autres terrains confisqués s’étendaient sur une surface de 50 000 mètres carrés. Les biens confisqués appartenaient aux sociétés Sud Fondi, Mabar et Iema, requérantes en l’espèce.
Les requérantes ont fait savoir qu’en avril 2006 les trois immeubles érigés avaient été démolis.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Les dispositions permettant d’apprécier le caractère abusif du lotissement
La protection des lieux pouvant être considérés comme sites naturels remarquables (bellezze naturali) est réglementée par la loi no 1497 du 29 juin 1939, qui prévoit le droit de l’Etat d’imposer une « contrainte de paysage » (vincolo paesaggistico) sur les sites à protéger.
Le Décret du Président de la République no 616 de 1977
Par le DPR no 616 du 1977, l’Etat a délégué aux Régions les fonctions administratives en matière de protection des sites naturels remarquables.
La loi no 431 de 8 août 1985 (Dispositions urgentes en matière des sites présentant un grand intérêt pour l’environnement).
L’article 1 de cette loi soumet à des « limitations visant à protéger le paysage et l’environnement au sens de la loi no 1497 de 1939 (vincolo paesaggistico ed ambientale), entre autres, les zones côtières situées à moins de 300 mètres de la ligne de brisement des vagues, même pour les terrains surplombant la mer. »
Il en découle l’obligation de demander aux autorités compétentes un avis de conformité avec la protection du paysage de tout projet de modification des lieux.
« Ces limitations ne s’appliquent pas aux terrains inclus dans les « zones urbaines A et B ». Pour les terrains inclus dans d’autres zones, ces limitations ne s’appliquent pas à ceux qui sont inclus dans un plan urbain de mise en œuvre. »
Par cette loi, le législateur a soumis le territoire à une protection généralisée. Celui qui ne respecte pas les contraintes prévues à l’article 1, est puni notamment aux termes de l’article 20 de la loi no 47 de 1985 (sanctions prévues en matière d’urbanisme, voir infra).
La loi no 10 du 27 janvier 1977 (Dispositions en matière de constructibilité des sols)
La loi no 10 du 27 janvier 1977 prévoit à l’article 13 que les plans généraux d’urbanisme peuvent être réalisés à condition qu’un plan ou un programme urbain de mise en œuvre (piano o programma di attuazione) existe. Ce programme de mise en œuvre doit délimiter les zones dans lesquelles les dispositions des plans généraux d’urbanisme doivent être mises en œuvre.
Il incombe aux Régions de décider du contenu et de la procédure permettant d’aboutir à un plan urbain de mise en œuvre et d’établir la liste des villes exonérées de l’obligation d’adopter un plan de mise en oeuvre.
Lorsqu’une ville est obligée d’adopter un plan de mise en œuvre, les permis de construire ne peuvent être délivrés par le maire que si les permis litigieux ne visent une zone incluse dans le programme de réalisation (sauf exceptions prévues par la loi) et que si le projet est conforme au plan général d’urbanisme.
Aux termes de l’article 9, les villes exonérées de l’obligation d’adopter un plan de mise en œuvre peuvent délivrer des permis de construire.
La loi de la Région des Pouilles no 56 du 31 mai 1980
La loi régionale no 56 du 31 mai 1980, à son article 51 alinéa f), dispose :
« ... Jusqu’à l’entrée en vigueur des plans d’urbanisme territoriaux...
F) Il est interdit de construire à moins de 300 mètres de la limite avec le domaine maritime[1] ou du point le plus élevé surplombant la mer.
En cas de plan d’urbanisme (strumento urbanistico) déjà en vigueur ou adopté au moment de l’entrée en vigueur de cette loi, il est possible de construire seulement dans les zones A, B et C au sein des centres habités et au sein des installations touristiques. En outre, il est possible de construire des ouvrages publics et d’achever des installations industrielles et artisanales qui étaient en cours de construction à l’entrée en vigueur de cette loi »
La loi no 47 du 27 février 1985 (Dispositions en matière de contrôle de l’activité urbaine et de construction, sanctions, récupération et régularisation des ouvrages) définit le « lotissement abusif » à son article 18 :
« Il y a lotissement abusif d’un terrain en vue de la construction,
a) en cas de commencement d’ouvrages impliquant une transformation urbaine non conforme aux plans d’urbanisme (strumenti urbanistici), déjà en vigueur ou adoptés, ou en tout cas non conforme aux lois de l’Etat ou des Régions ou bien en l’absence de l’autorisation requise ; (...) »
Cette disposition a été interprétée dans un premier temps dans le sens d’exclure le caractère abusif d’un lotissement lorsque les autorités compétentes ont délivré les permis requis (Cour de cassation, Section 3, arrêt no 6094/1991, Ligresti ; 18 octobre 1988, Brulotti).
Elle a ensuite été interprétée dans le sens que, même s’il est autorisé par les autorités compétentes, un lotissement non conforme aux dispositions urbaines en vigueur est abusif (voir l’arrêt de la Cour de cassation du cas d’espèce, précédé par Cour de cassation, section 3, 16 novembre 1995, Pellicani, et 13 mars 1987, Ginevoli ; et confirmé par le Sections Réunies de la Cour de cassation, arrêt no 5115 de 2002, Spiga).
a) L’article 27 de la Constitution italienne prévoit que « la responsabilité pénale est personnelle ». La Cour constitutionnelle a affirmé à plusieurs reprises qu’il ne peut y avoir de responsabilité objective en matière pénale (voir, parmi d’autres, Cour constitutionnelle, arrêt no 1 du 10 janvier 1997, et infra, « autres cas de confiscation »).
b) L’article 25 de la Constitution prévoit, à son deuxième alinéa, que « personne ne peut être puni en l’absence d’une loi entrée en vigueur avant la commission des faits ».
c) L’article 1 du code pénal prévoit que « personne ne peut être puni pour un fait qui n’est pas expressément prévu par la loi comme étant constitutif d’une infraction pénale, et avec une peine qui n’est pas établie par la loi ».
d) L’article 42, 1er alinéa du code pénal prévoit que « l’on ne peut être puni pour une action ou une omission constituant une infraction pénale prévue par la loi si, dans la commission des faits, l’auteur n’avait pas de conscience et volonté (coscienza e volontà) ».
« 1er alinéa : En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation des choses qui ont servi ou qui furent destinées à la commission de l’infraction, ainsi que les choses qui sont le produit ou le bénéfice de l’infraction.
2ème alinéa : La confiscation est toujours ordonnée :
1. Pour les choses qui constituent le prix de l’infraction ;
2. Pour les choses dont la fabrication, l’usage, le port, la détention ou l’aliénation sont pénalement interdites.
3ème alinéa : Dans les cas prévus au premier alinéa et au point 1 du deuxième alinéa, la confiscation ne peut frapper les tiers (« personnes étrangères à l’infraction ») propriétaires des choses en question.
4ème alinéa : Dans le cas prévu au point 2 du deuxième alinéa, la confiscation ne peut frapper les tiers (« personnes étrangères à l’infraction ») propriétaires lorsque la fabrication, l’usage, le port, la détention ou l’aliénation peuvent être autorisés par le biais d’une autorisation administrative. »
En tant que mesure de sûreté, la confiscation relève de l’article 199 du code pénal qui prévoit que « personne ne peut être soumis à des mesures de sûreté non prévues par la loi et en dehors des cas prévus par la loi ».
En matière de douanes et de contrebande, les dispositions applicables prévoient la possibilité de confisquer des biens matériellement illicites, même si ces derniers sont détenus par des tiers. Par l’arrêt no 229 de 1974, la Cour constitutionnelle a déclaré les dispositions pertinentes incompatibles avec la Constitution (notamment l’article 27), sur la base du raisonnement suivant :
« Il peut y avoir des choses matériellement illicites, dont le caractère illicite ne dépend pas de la relation avec la personne qui en dispose. Ces choses doivent être confisquées auprès toute personne les détenant à n’importe quel titre (... ).
Pour éviter que la confiscation obligatoire des choses appartenant à des tiers -étrangers à la contrebande - ne se traduise en une responsabilité objective à leur charge - à savoir une responsabilité du simple fait qu’ils sont propriétaires des choses impliquées - et pour éviter qu’ils subissent les conséquences patrimoniales des actes illicites commis par d’autres, il faut que l’on puisse reprocher à ces tiers un quid sans lequel l’infraction (...) n’aurait pas eu lieu ou n’aurait pas été favorisée. En somme, il faut pouvoir reprocher à ces tiers un manque de vigilance. »
La Cour constitutionnelle a réitéré ce principe dans les arrêts no 1 de 1997 et no 2 de 1987, en matière de douanes et d’exportation d’œuvres d’art.
La confiscation du cas d’espèce (article 19 de la loi no 47 du 28 février 1985)
L’article 19 de la loi no 47 du 28 février 1985 prévoit la confiscation des ouvrages abusifs aussi bien que des terrains lotis de manière abusive, lorsque les juridictions pénales ont établi par un arrêt définitif que le lotissement est abusif. L’arrêt pénal est immédiatement transcrit dans les registres immobiliers.
L’article 20 de la loi no 47 du 28 février 1985
Cette disposition prévoit des sanctions définies comme étant des « sanctions pénales ». La confiscation n’y figure pas.
En cas de lotissement abusif - tel que défini à l’article 18 de cette même loi – les sanctions prévues sont l’emprisonnement jusqu’à deux ans et l’amende jusqu’à 100 millions de lires italiennes (environ 516 460 euros).
L’article 44 du code de la construction (DPR no 380 de 2001)
Le décret de Président de la République du 6 juin 2001 no 380 (Testo unico delle disposizioni legislative et regolamentari in materia edilizia) a codifié les dispositions existantes notamment en matière de droit de bâtir. Au moment de la codification, les articles 19 et 20 de la loi no 47 de 1985 ci-dessus ont été unifiés en une seule disposition, à savoir l’article 44 du code, qui est ainsi titré :
(...)
2. La confiscation des ouvrages abusifs aussi bien que des terrains lotis de manière abusive, lorsque les juridictions pénales ont établi par un arrêt définitif que le lotissement est illégal. »
La jurisprudence relative à la confiscation pour lotissement abusif
Dans un premier temps, les juridictions nationales avaient classé la confiscation applicable en cas de lotissement abusif comme étant une sanction pénale. Dès lors, elle ne pouvait être appliquée qu’aux biens du prévenu reconnu coupable du délit de lotissement illégal, conformément à l’article 240 du code pénal (Cour de cassation, Sec. 3, 18 octobre 1988, Brunotti ; 8 mai 1991, Ligresti ; Sections Unies, 3 février 1990, Cancilleri).
Par un arrêt du 12 novembre 1990, la Section 3 de la Cour de cassation (affaire Licastro) affirma que la confiscation était une sanction administrative et obligatoire, indépendante de la condamnation au pénal. Elle pouvait donc être prononcée à l’égard de tiers, puisqu’à l’origine de la confiscation il y a une situation (une construction, un lotissement) qui doit être matériellement abusive, indépendamment de l’élément moral. De ce fait, la confiscation peut être ordonnée lorsque l’auteur est acquitté en raison de l’absence d’élément moral (« perché il fatto non costituisce reato »). Elle ne peut pas être ordonnée si l’auteur est acquitté en raison de la non matérialité des faits (« perché il fatto non sussiste »).
Cette jurisprudence fut largement suivie (Cour de Cassation, Section 3, arrêt du 16 novembre 1995, Besana ; no 12471, no 1880 du 25 juin 1999, Negro ; 15 mai 1997 no 331, Sucato ; 23 décembre 1997 no 3900, Farano ; no 777 du 6 mai 1999, Iacoangeli). Par l’ordonnance no 187 de 1998, la Cour constitutionnelle a reconnu la nature administrative de la confiscation.
Tout en étant considérée comme étant une sanction administrative par la jurisprudence, la confiscation ne peut être annulée par un juge administratif, la compétence en la matière relevant uniquement du juge pénal (Cour de cassation, Sec. 3, arrêt 10 novembre 1995, Zandomenighi).
La confiscation de biens se justifie puisque ceux-ci sont les « objets matériels de l’infraction ». En tant que tels, les terrains ne sont pas « dangereux », mais ils le deviennent lorsqu’ils mettent en danger le pouvoir de décision qui est réservé à l’autorité administrative (Cour de cassation, Sec. 3, no 1298/2000, Petrachi et autres).
Si l’administration régularise ex post le lotissement, la confiscation doit être révoquée (Cour de cassation, arrêt du 14 décembre 2000 no 12999, Lanza ; 21 janvier 2002, no 1966, Venuti).
Le but de la confiscation est de rendre indisponible une chose dont on présume ou on connaît la dangerosité : les terrains faisant l’objet d’un lotissement abusif et les immeuble abusifs construits. On évite ainsi la mise sur le marché immobilier d’immeubles abusifs. Quant aux terrains, on évite la commission d’infractions ultérieures et on ne laisse pas de place à des pressions éventuelles sur les administrateurs locaux afin qu’ils régularisent la situation (Cour de cassation, Sec. 3, 8 février 2002, Montalto).
1. Les requérantes se plaignent de la confiscation de leur biens, qu’elles tiennent pour illégale. Elles allèguent la violation de l’article 7 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
2. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, les requérantes dénoncent le caractère disproportionné de la confiscation qui a frappé leurs biens.
1. Les requérantes dénoncent l’illégalité de la confiscation qui a frappé leurs biens au motif que cette sanction aurait été infligée dans un cas non prévu par la loi. Elles allèguent la violation de l’article 7 de la Convention, qui dispose :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
Arguments du Gouvernement
Le Gouvernement observe d’emblée que la confiscation litigieuse ne relève pas de l’article 7 de la Convention, au motif qu’il s’agit d’une sanction administrative. Ce faisant, le Gouvernement soulève en substance une exception d’irrecevabilité ratione materiae.
A l’appui de cette thèse, le Gouvernement observe que la nature administrative de la sanction est confirmée par la jurisprudence de la Cour de cassation. En particulier, la jurisprudence a affirmé que la confiscation prévue par la loi no 47 de 1985 ne relève pas du deuxième alinéa de l’article 240 du code pénal, vu que les terrains en tant que tels ne sont des « biens dont l’usage, la détention ou la vente constituent une infraction pénale ». En outre, la confiscation en question ne relève pas du premier alinéa de l’article 240 du code pénal, vu qu’elle peut être ordonnée même en cas d’acquittement et à l’égard de tiers (Cour de cassation, Section 3, 6 mai 1999, no 777, Iacoangeli ; 18 mai 1999, no 1880, Negro).
Quant au but de la confiscation, le Gouvernement observe qu’il ne s’agit pas de réprimer un comportement mais de rendre le territoire conforme à la planification urbaine, et d’empêcher que les terrains abusivement lotis ne soient ultérieurement exploités. La confiscation se justifie par la dangerosité des biens confisqués au cas où ceux-ci seraient restés à la disposition de sujets autres que l’administration, en particulier de l’auteur de la conduite incriminée, et par la nécessité de protéger la collectivité, la santé et la sécurité.
La confiscation a été ordonnée à l’égard des sociétés requérantes – qui sont tierces par rapport aux accusés – vu que le but de cette mesure n’est pas celui de punir un comportement : il s’agit d’une sanction fondée sur l’illégalité objective des lotissements, en l’absence de condamnation pénale.
Le Gouvernement expose qu’en droit italien, d’autres cas de confiscation peuvent frapper des tiers, en raison de l’illégalité matérielle des biens (en cas de contrebande, article 301 du Décret du Président de la République no 43 du 23 janvier 1973 ; en cas d’exportation illégale de biens artistiques ou culturels, article 123 du Code des biens culturels). En outre, le fait que la confiscation ait été ordonnée par les juridictions pénales n’affecte pas le caractère administratif de la sanction, puisque les juridictions pénales agiraient en remplacement des juridictions administratives. Ceci implique qu’une confiscation doit être révoquée par le juge pénal si l’administration décide de régulariser les lotissements jugés comme étant abusifs. Enfin, le Gouvernement observe que les biens confisqués sont acquis au patrimoine communal et non pas au patrimoine de l’Etat, ce qui différencie ultérieurement la sanction administrative d’une sanction pénale.
Quant enfin à la gravité de la sanction, le Gouvernement estime que celle-ci « ne doit pas s’apprécier par rapport à la répression du non-respect des dispositions urbaines, mais par rapport à la planification du territoire. »
Pour le cas où la Cour conclurait à l’applicabilité de l’article 7 en l’espèce, le Gouvernement observe que le délit de lotissement abusif est prévu par des lois accessibles et prévisibles.
Le Gouvernement soutient que l’argument des requérantes selon lequel les limitations frappant les terrains en cause n’étaient pas prévues par la loi est infondé. D’une part, l’article 51 f) de la loi régionale no 56 de 1980 interdisait et, d’autre part, la loi no 431 de 1985 en vigueur depuis le 15 septembre 1985 soumettaient à des limitations les terrains en cause.
Ces contraintes ex lege existaient avant l’arrêté ministériel du 30 juin 1999 déclarant certaines parties du territoire de la ville de Bari comme étant d’intérêt remarquable pour le paysage.
Le Gouvernement admet que l’administration s’est conduite comme si tout était dans l’ordre. Cependant, son comportement n’aurait pas été transparent et conforme aux normes de bonne administration.
Le Gouvernement soutient que la confiscation litigieuse était « prévue par la loi ». A cet égard, il observe que l’article 19 de la loi no 47 de 1985 n’exige pas la condamnation de l’auteur de l’infraction, mais seulement le constat du caractère illégal du lotissement. Le fait que l’article 19 de cette loi ne spécifie pas que la confiscation peut avoir lieu uniquement en cas de condamnation permet au juge pénal d’ordonner la confiscation dans le cas d’un acquittement où il a tout de même constaté le caractère matériellement illégal d’un lotissement. Il s’agit en effet d’une sanction réelle et non personnelle. Il est donc possible de confisquer dans le cas d’un acquittement comme celui de l’espèce, où l’élément moral fait défaut. Ceci est confirmé par une abondante jurisprudence.
Tout en ayant indiqué pour les besoins du paragraphe précédant que la confiscation ne relève pas de l’article 240 du code pénal selon la jurisprudence, et que ceci prouve la nature administrative de la sanction, le Gouvernement observe que la confiscation pourrait s’analyser comme étant une « mesure de sûreté patrimoniale » relevant de l’article 240 du code pénal, deuxième alinéa, point 2. Cette disposition indique que « le juge ordonne toujours la confiscation des choses dont la fabrication, l’usage, le port, la détention ou l’aliénation constitue une infraction pénale, même s’il n’y a pas eu de condamnation pénale ».
Le Gouvernement observe que toute mesure de sûreté, comme toute peine, est ordonnée dans le respect du principe de légalité et renvoie à l’article 199 du code pénal, qui prévoit que « personne ne peut être soumis à des mesures de sûreté non prévues par la loi et en dehors des cas prévus par la loi ».
La possibilité de confisquer les constructions abusives est prévue par l’article 240 du code pénal, 2ème alinéa, dans la mesure où ces constructions sont des « choses dont la fabrication est pénalement interdite ». Elle est également prévue par l’article 19 de la loi no 47 de 1985.
La possibilité de confisquer les sols faisant l’objet d’un lotissement abusif est uniquement prévue par l’article 19 de la loi no 47 de 1985. En effet, les sols ne sont pas « intrinsèquement dangereux ».
Le fait que la confiscation ait été ordonnée à l’égard des sociétés requérantes, tierces par rapport aux accusés, se justifie par la nature « réelle » de la sanction.
Selon le Gouvernement, il n’y a pas de conflit avec le principe de « responsabilité personnelle » selon l’article 27 de la Constitution, au motif que la confiscation n’a pas une finalité répressive mais préventive. Il s’agit de rendre indisponible pour le possesseur une chose dont on présume ou on connaît la dangerosité, d’éviter de mettre sur le marché des constructions abusives, et d’empêcher la commission d’infractions ultérieures.
Arguments des requérantes
Les requérantes s’opposent aux arguments du Gouvernement et soutiennent que la confiscation litigieuse est une sanction pénale.
Tout d’abord, même s’il y a eu acquittement par manque d’élément moral, la confiscation se rattache à une « infraction pénale », ce qui n’a pas été contesté par le Gouvernement.
Ensuite, la confiscation a un but punitif, aussi bien pour la particularité de sa nature que pour les conditions de son application. En effet, la sanction a été ordonnée dans le cadre d’une accusation en matière pénale, à la suite de l’établissement de l’élément matériel de l’infraction. En outre, les buts préventif et compensatoire se concilient avec le but répressif et peuvent être considérés comme des éléments constitutifs de la notion même de peine.
Quant à la qualification en droit interne de la sanction, les requérantes font observer que, jusqu’en 1990, la confiscation avait été classée par les juridictions nationales parmi les sanctions pénales. Ce n’est qu’à partir de 1990 que la jurisprudence a évolué dans le sens de considérer la confiscation comme étant une sanction administrative, dans le but de pouvoir l’infliger indépendamment de la condamnation pénale et aussi à l’égard de tiers.
Se référant à l’affaire Öztürk c. Allemagne (arrêt du 21 février 1984, série A no 73, § 49), les requérantes soutiennent que le changement d’interprétation par la jurisprudence ne doit en tout cas pas influencer l’applicabilité en l’espèce des garanties prévues par l’article 7 de la Convention.
Quant au fait que le juge pénal se prononce sur la confiscation, ceci ne fait que renforcer la nature pénale de la sanction. En effet, le juge pénal ne « remplace » pas les juridictions administratives, puisque la loi ne le prévoit pas, mais il inflige une sanction pénale qui relève de sa compétence.
La gravité de la sanction permet enfin d’exclure qu’il s’agisse d’une sanction ayant nature compensatoire. Il s’agit d’une sanction pénalisant les requérantes de manière substantielle, ce qui indique une intention de dissuasion et punition (50 000 mètres carrés de terrain, dont seulement 7 000 mètres carrés bâtis).
Les requérantes soutiennent que le caractère abusif des lotissements n’était pas « prévu par la loi ». Leurs doutes quant à l’accessibilité et à la prévisibilité des dispositions applicables seraient confirmés par l’arrêt de la Cour de cassation, par lequel les accusés ont été acquittés pour l’« erreur excusable » commise dans l’interprétation du droit applicable, compte tenu de la législation régionale obscure, de l’obtention des permis de construire, des assurances reçues de la part des autorités locales quant à la régularité de leurs projets et de l’inertie des autorités compétentes en matière de protection du paysage jusqu’en 1997.
Les requérantes soutiennent ensuite qu’il n’y avait pas d’illégalité matérielle en l’espèce, puisque les lotissements ne se heurtaient pas à des limitations frappant leurs terrains. Sur ce point, elles se réfèrent à l’arrêt de la cour d’appel de Bari, qui n’a constaté aucune illégalité matérielle, estimant qu’aucune interdiction de construire ne frappait les terrains en cause. En outre, le fait que le ministère des biens culturels ait pris un arrêté le 30 juin 1999 soumettant les terrains en cause à des contraintes prouverait qu’antérieurement, aucune contrainte ne gravait sur lesdits terrains.
Les requérantes soutiennent que pour être légale, une peine doit être prévisible, à savoir il doit être possible de prévoir raisonnablement au moment de la commission de l’infraction les conséquences y afférentes au niveau de la sanction, aussi bien en ce qui concerne le type de sanction que la mesure de la sanction.
En outre, pour être compatible avec l’article 7 de la Convention, une peine doit se rattacher à un comportement reprochable.
Les requérantes estiment que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce.
D’une part, la loi no 47 de 1985 ne prévoyant pas de manière explicite la possibilité de confisquer les biens de tiers en cas d’acquittement des accusés, il serait « non prévu par la loi » de confisquer dans un tel cas, comme celui de l’espèce. L’interprétation non littérale de l’article 19 de la loi no 47/1985 est arbitraire puisqu’on est dans le domaine pénal et l’interprétation par analogie au détriment de l’intéressé ne peut pas être utilisée. En outre, une telle interprétation se heurte à l’article 240 du code pénal, qui établit le régime général des confiscations.
D’autre part, les requérantes estiment que la confiscation a été ordonnée sur la base d’une responsabilité pénale objective, prohibée en droit italien. Au vu de leur statut de « tiers » par rapport aux accusés et au vu de l’acquittement de ceux-ci et des motivations de l’acquittement, rien ne peut être reproché aux sociétés requérantes. Ces dernières invoquent à cet égard le principe de la « responsabilité pénale personnelle » prévu par la Constitution, et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle selon laquelle une confiscation ne peut frapper les biens des tiers étrangers à l’infraction que « lorsqu’à ceux-ci l’on peut reprocher un quid sans lequel l’infraction n’aurait pas eu lieu ou n’aurait pas été favorisée ». En outre, les requérantes invoquent le principe selon lequel une personne morale ne peut pas être pénalement responsable (societas delinquere non potest). En conclusion, la confiscation de l’espèce se heurte à l’interdiction de la responsabilité pénale objective.
Les requérantes rappellent enfin que jusqu’en 1990, la confiscation avait été classée par les juridictions nationales parmi les sanctions pénales. De ce fait, elle pouvait frapper uniquement les biens de l’accusé (Cour de cassation, Section 3, 16 novembre 1995, Befana; 24 février 1999, Iacoangeli). Ce n’est qu’à partir de 1990 que la jurisprudence a évolué dans le sens de considérer la confiscation comme étant une sanction administrative et donc pouvant s’infliger indépendamment de la condamnation pénale et aussi à l’égard de tiers.
Selon elles un tel revirement de jurisprudence a eu lieu uniquement pour permettre la confiscation des biens de tiers en cas d’acquittement des accusés, comme en l’espèce.
Appréciation de la Cour
a) Sur l’applicabilité de l’article 7 au cas d’espèce
La Cour doit déterminer si la sanction patrimoniale infligée aux sociétés requérantes constituait une « peine » aux termes de l’article 7 § 1 de la Convention. Le libellé de cette disposition indique que le point de départ de toute appréciation de l’existence d’une peine consiste à déterminer si la mesure en question est imposée à la suite d’une condamnation pour une « infraction ». D’autres éléments peuvent être jugés pertinents à cet égard : la nature et le but de la mesure en cause, sa qualification en droit interne, les procédures associées à son adoption et à son exécution, ainsi que sa gravité (Welch c. Royaume-Uni, arrêt du 9 février 1995, série A no 307-A, p. 13, § 28).
La notion de « peine » possédant une portée autonome, la Cour doit, pour rendre efficace la protection offerte par cette disposition, demeurer libre d’aller au-delà des apparences et apprécier elle-même si une mesure particulière s’analyse au fond en une « peine » au sens de cette clause (Öztürk c. Allemagne, arrêt du 21 février 1984, série A no 73, §§ 49 et 50 ; Welch précité, p. 13, § 27, et Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 145, CEDH 2000-VII).
En l’espèce, aucune condamnation pénale préalable n’a été prononcée à l’encontre des sociétés requérantes ou de leurs représentants par les juridictions italiennes (voir, mutatis mutandis, Valico c.Italie (déc.), no 70074/01, 21 mars 2006 ; Yildirim c. Italie (déc.), no 38602/02, CEDH 2003-IV). Ces derniers ont été acquittés, l’élément moral de l’infraction faisant défaut.
Or, la Cour estime que la confiscation litigieuse se rattachait à une « infraction pénale » fondée sur des dispositions juridiques générales.
Ce point n’a d’ailleurs pas été contesté par le Gouvernement, qui, dans ses observations, se réfère au lotissement abusif comme à un « délit ».
La Cour note ensuite que le caractère matériellement illégal des lotissements a été constaté par les juridictions pénales. La confiscation a été ordonnée à l’égard des requérantes pour des raisons objectives, sans qu’il ait été nécessaire ou possible d’établir l’existence d’une intention ou d’une négligence de leur part.
En outre, la Cour observe que la sanction prévue à l’article 19 de la loi no 47 de 1985 ne tend pas à la réparation pécuniaire d’un préjudice, mais vise pour l’essentiel à punir pour empêcher la réitération de manquements aux conditions fixées par la loi (voir, mutatis mutandis et en relation à la notion d’« accusation en matière pénale », Bendenoun c. France, arrêt du 24 février 1994, série A no 284, p. 20, § 47 ; Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, § 38, CEDH 2006‑...). Cette conclusion est renforcée par le constat que la confiscation a frappé à 85% des terrains non construits, donc en l’absence d’une atteinte réelle au paysage. Cette pénalité était donc à la fois préventive et répressive, cette dernière caractéristique étant celle qui distingue d’habitude les sanctions pénales (Öztürk c. Allemagne, arrêt du 21 février 1984, série A no 73, pp. 20-21, § 53).
De surcroît, la Cour relève la gravité de la sanction qui, selon la loi no 47 de 1985, implique tous les terrains inclus dans le projet de lotissement, et qui, en pratique, a concerné 50 000 mètres carrés de terrain.
La Cour relève enfin que le code de la construction de 2001 classe parmi les sanctions pénales, la confiscation pour lotissement abusif.
Compte tenu des éléments plus haut, la Cour estime que la confiscation litigieuse est une « peine » au sens de l’article 7 de la Convention.
Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Les requérantes dénoncent l’illégalité ainsi que le caractère disproportionné de la confiscation qui a frappé leurs biens. Elles allèguent la violation de l’article 1 du Protocole no 1, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Arguments des parties
S’agissant de la légalité de la confiscation sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, le Gouvernement observe que les dispositions applicables en l’espèce sont accessibles, dans la mesure où les lois et les plans d’urbanisme en cause sont publiés. En outre, la jurisprudence en la matière a été développée de manière raisonnable, de façon à ce que les intéressés soient en mesure de prévoir raisonnablement les conséquences d’un acte.
Se référant à la jurisprudence de la Cour (Chorherr c. Autriche, arrêt du 25 août 1993, série A no 266‑B, § 25 ; Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, arrêt du 29 octobre 1992, série A no 246‑A, § 60), le Gouvernement observe que la qualité de la loi dépend en la matière et de la qualité des destinataires. Selon lui, vu l’importance du projet de construction, les requérantes ne sont pas assimilables à de simples citoyens. Elles doivent passer pour des professionnels de la construction, conseillés par des experts, desquels une diligence spéciale pouvait être attendue. En outre, le niveau d’accessibilité exigé serait moins rigoureux vu qu’en l’espèce le droit en cause n’est pas de ceux auxquels on ne peut pas déroger.
Quant au but de la confiscation, celui-ci était légitime, dans la mesure où il s’agissait de revenir à la légalité en acquérant au patrimoine communal les biens litigieux.
Les requérantes soutiennent que la confiscation litigieuse ne repose par sur une base légale accessible, précise et prévisible et elles dénoncent les effets de son application au cas d’espèce. Les requérantes reprennent pour l’essentiel les arguments déjà avancés sous l’angle de l’article 7 de la Convention, à savoir que la confiscation a été ordonnée dans un cas non prévu par la loi et pour une situation qui n’est pas matériellement illégale et dont l’illégalité n’était pas prévisible.
S’agissant de la proportionnalité de la confiscation, le Gouvernement rappelle que le but de la confiscation était celui de revenir à une situation de légalité et que ce but a été atteint en transférant à la ville de Bari les constructions et les terrains appartenant aux sociétés requérantes.
Selon le Gouvernement, les moyens utilisés pour atteindre ce but n’ont pas enfreint le juste équilibre. Il était nécessaire de rendre indisponibles les terrains, pour empêcher la commission ultérieure d’actes incompatibles avec les dispositions pertinentes, ainsi que pour éviter que des pressions sur les administrations locales soient exercées afin que celles-ci régularisent la situation. Il était également nécessaire de confisquer les immeubles construits, pour éviter leur utilisation et leur exploitation.
En conclusion, aucun problème de proportionnalité ne se pose en l’espèce.
Les requérantes s’opposent à cette thèse et allèguent avoir eu à supporter une charge exorbitante, vu que la confiscation a frappé non seulement les constructions mais aussi les sols, et non seulement les sols construits mais aussi la totalité de ceux-ci.
Selon elles, la plupart de la surface confisquée n’étant pas bâtie, il n’y a pas eu de préjudice à l’environnement. En effet, ce n’est qu’au moment de la construction qu’une atteinte effective aux intérêts publics peut se produire.
En outre, l’autorité administrative avait d’autres moyens à sa disposition pour atteindre les buts visés. L’autorité aurait notamment pu révoquer son accord et dénoncer les conventions de lotissement. Tout risque d’usage dangereux des terrains aurait été ainsi éliminé.
La confiscation revient ainsi selon elles à une expropriation sans indemnité susceptible de rompre le juste équilibre et, en tout cas, à une ingérence disproportionnée, compte tenu également de la bonne foi des requérantes, de l’acquittement de leurs représentants et du fait qu’elles répondent du comportement de tierces personnes.
Appréciation de la Cour
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
S. Dollé F. Tulkens
Greffière Président
[1] Le domaine maritime est défini à l’article 28 du code de la navigation. Il comprend notamment les plages et le « lido », à savoir (selon la jurisprudence) la zone du rivage qui est submergée par la mer en cas de « mareggiata » (mer agitée), exclusion faite des tempêtes.